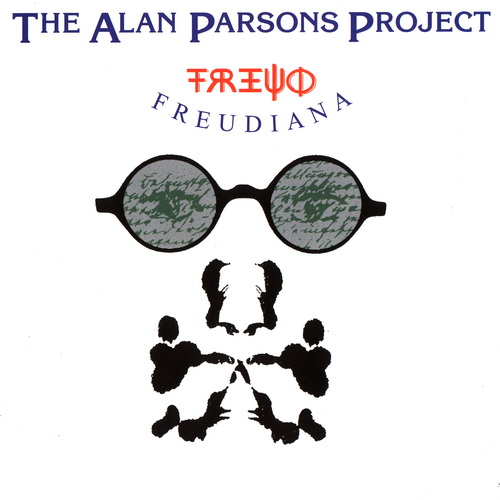À l’instar de la plupart des critiques du freudisme, Mikkel Borch-Jacobsen est volontiers assimilé à une sorte de chien de garde des TCC, animé par la haine et la vénalité. Or, à l’instar de ces mêmes critiques du freudisme, notamment de Jacques Van Rillaer et plus récemment de la fameuse Sophie Robert, il s’est préalablement intéressé de près à la discipline et surtout à son histoire. Un rapide survol des quelques documents et interviews disponibles sur le net permet de constater qu’il n’est pas forcément acquis au modèle « psy » anglo-saxon, et loin de manifester une foi aveugle en l’industrie pharmaceutique.
À l’instar de la plupart des critiques du freudisme, Mikkel Borch-Jacobsen est volontiers assimilé à une sorte de chien de garde des TCC, animé par la haine et la vénalité. Or, à l’instar de ces mêmes critiques du freudisme, notamment de Jacques Van Rillaer et plus récemment de la fameuse Sophie Robert, il s’est préalablement intéressé de près à la discipline et surtout à son histoire. Un rapide survol des quelques documents et interviews disponibles sur le net permet de constater qu’il n’est pas forcément acquis au modèle « psy » anglo-saxon, et loin de manifester une foi aveugle en l’industrie pharmaceutique.
Son dernier petit ouvrage s’attache à synthétiser les véritables parcours d’une trentaine de patients pris en charge par Freud. Cette triste réalité ne colle évidemment pas du tout aux vignettes clinique correspondantes dans les écrits du viennois, des écrits sur lesquels se basent ou reviennent régulièrement de nombreux psychanalystes, aujourd’hui encore. Ces cas cliniques arrangés demeurent ainsi autant de mythes fondateurs d’une discipline qui reste encore considérée « religieusement » comme thérapeutique alors qu’elle repose (et s’entretient) sur des mensonges.
Je reste pour ma part toujours navré de constater à quel point une certaine tolérance s’est installée parallèlement au développement de cette foi dans les différentes sphères de la santé mentale. Ainsi, face à l’évidence, les arguments demeurent inchangés, piégés par l’autorité, par la réciprocité, par la spirale de l’engagement, et totalement superposables à ceux d’Elisabeth Teissier défendant l’astrologie :
Les historiens de la psychanalyse qui ne sont pas acquis à la cause seraient pour la plupart des révisionnistes qui auraient des comptes (plus ou moins conscients) à régler avec la discipline. Leurs travaux ne seraient donc pas valables. L’auteur leur répond :
Demande-t-on au plombier pourquoi il fait de la plomberie ? Il se trouve qu’à force de travailler sur l’histoire de la psychanalyse, j’ai développé une certaine compétence en la matière. Eh bien, cette compétence, je l’exerce, voilà tout. Pour répondre plus précisément à votre question : je n’ai pas commencé à fouiller dans les archives du freudisme parce que je voulais me payer Freud. C’est l’inverse : c’est parce qu’au cours de mes recherches je suis tombé sur des documents et des témoignages qui contredisaient l’histoire officielle de la psychanalyse que je suis progressivement devenu critique à l’égard de la psychanalyse, ce que je n’étais pas au début. Dès lors que je découvrais, à la suite de bien d’autres historiens de la psychanalyse, des choses qui ne rentraient pas dans le cadre de la légende freudienne, je n’allais pas m’asseoir dessus. J’ai partagé le fruit de ces recherches avec le public, comme le ferait n’importe quel chercheur dans un autre domaine. Je trouve ça normal et je n’éprouve aucun besoin de m’en excuser ou de me justifier. Je sais bien qu’on m’accuse depuis longtemps d’être névrotiquement attaché à Freud, mais je laisse dire. Ce genre d’interprétations psychanalytiques me laissent froid.
Pour d’autres, ces falsifications freudiennes sont connues depuis longtemps, mais ça n’enlève rien à la valeur de la psychanalyse. Il s’agit d’un argument qui ne vaut guère mieux que l’éternel « il y a des bons et des mauvais psychanalystes » (le terme psychanalyste pouvant être allègrement remplacé par astrologue ou prêtre pour défendre respectivement ces deux domaines respectifs). Valider soi-même ses théories par la simple observation de ses propres patients constitue déjà en soi une méthode douteuse, mais s’il s’avère que ces fameux cas sont réarrangés pour confirmer ces fameuses théories, la méthode n’est plus douteuse, c’est une escroquerie. La médecine basée sur les preuves est loin d’être parfaite, et peut dévoiler des conflits d’intérêt colossaux, mais ne laisserait certainement pas se développer de telles mystifications de nos jours.
Je ne m’attarderai pas trop sur les diversions habituelles qui sont autant d’idées reçues et très bien relayées, comme quoi la psychanalyse serait la seule approche garante de la liberté, de la singularité du sujet, qu’elle constitue le seul rempart contre l’invasion du dressage TCC et des médicaments empoisonnés, que sans cette psychanalyse nous serons bientôt tous considérés comme malades, à dresser et à médicamenter…
Je rappelle tout d’abord qu’en divisant l’humanité entre névrose et psychose, Freud nous a tous rendus malades, ou du moins bien écartés de la possibilité d’une bonne santé mentale. Par ailleurs, la plupart de ses patients, issus de la bourgeoisie viennoise, étaient médicamentés (morphine, chloral etc.), et pas à petites doses, ce qui n’est évidemment pas précisé dans les vignettes officielles.
Par ailleurs, non seulement la psychanalyse implique l’écoute (comme la plupart des autres courants) mais elle consiste également à faire rentrer les patients dans des cases. Le psychanalyste, comme le comportementaliste, cherchera évidemment à modéliser le cas singulier selon la grille de lecture du « maître » auquel il se réfère (Freud, Jung, Lacan etc.), du moins s’il souhaite vraiment appliquer sa discipline et non improviser totalement. Ce qui caractérise davantage l’approche psychanalytique, c’est l’étape ultérieure : celle de l’irréfutabilité des pseudosciences, à savoir que le cas finira forcément par rentrer dans la case qui lui est destinée, même si cela implique des efforts d’interprétation symbolique ahurissants, et même si l’évolution du patient n’est pas favorable. L’approche des TCC implique de revoir cette modélisation initiale si l’évolution n’est pas favorable, et notamment d’établir une nouvelle analyse fonctionnelle en y intégrant certains éléments qui auraient été omis ou insuffisamment pris en compte dans la précédente, cette analyse fonctionnelle étant évidemment spécifique à chaque patient contrairement à ce qu’on entend.
Je m’arrête là et vous recommande bien entendu la lecture de ce petit livre très instructif.
Présentation de l’ouvrage (Sciences Humaine.com)
Qui étaient les patients de Freud ? (Sciences Humaine.com)
Mikkel Borch-Jacobsen : Que sont devenus les patients de Freud ? (Sciences Humaine.com)
On ne lira plus jamais Freud comme avant… (tobienathan’s Blog)