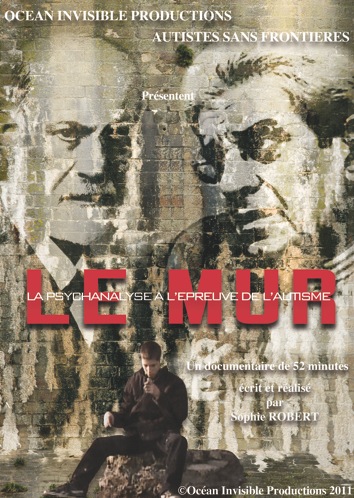Il n’est pas rare d’entendre un « psy » proclamer qu’un patient ne cherche qu’à mettre son travail, ou celui d’une institution, en échec. Cette déclaration solennelle est alors reprise en cœur par l’assistance soignante puis relayée parmi ses différents acteurs. Ceux-ci finissent par se liguer contre ce mauvais patient qui, non seulement refuse d’aller mieux, mais prendrait également un malin plaisir à saboter un travail au moins respectable, au mieux sacré. L’absence d’amélioration, voire l’aggravation de l’état de ce patient ne fera donc que vérifier cette théorie.
L’inconscient a bon dos
Celui qui remontera jusqu’à la proclamation initiale et cherchera des explications n’oubliera pas de mettre en lumière cet étrange paradoxe du sabotage d’un soin dont on fait soi-même la demande auparavant. Au sein des nombreuses et plus ou moins vaseuses justifications données par le « psy », l’inconscient tiendra une place fondamentale puisqu’il peut rendre viable tout paradoxe à priori insurmontable. Tantôt la demande de soin sera consciente, authentique, et la mise en échec inconsciente, liée à des conflits psychiques aussi obscurs que profondément refoulés. Tantôt la demande de soins sera inconsciente, indirectement formulée à travers un passage à l’acte, et la mise en échec également. Si la « conscience » ne peut fournir à la fois une demande de soin et une mise en échec de celui-ci, l’inconscient semble pouvoir supporter cette contradiction. Certains « psys » l’assumeront sans faiblir tandis que d’autres iront jusqu’à proposer la juxtaposition, superposition ou coexistence de plusieurs couches d’inconscience, chacune annulant la précédente. Cet échafaudage plus ou moins stable pourra donc tout expliquer, de l’amélioration inopinée à la dégradation tragique, en passant par la disparition inexpliquée.
Ambivalence, bénéfices secondaires et jouissance
D’autres « psys », certainement moins radicaux, recyclent (mal) cette notion d’ambivalence pour décrire un patient hésitant, tiraillé entre volonté et refus d’aller mieux. Interpellés sur les motivations plus ou moins conscientes d’un refus de guérir ou de se soigner, ces « psys » invoquent invariablement les bénéfices secondaires, ces fameux « avantages » liés à la maladie qui pousseraient un patient à se conforter dans la souffrance. Il peut alors s’agit de l’assistance de proches, de soignants, de gains plus matériels, donc de processus que l’on imaginait plutôt favoriser les soins mais qui finalement les entraveraient. Les plus extrémistes de ces « psys » n’hésitent pas à envisager que le patient puisse de ce fait jouir de son symptôme, et s’offusqueront que cette notion de jouissance soit mal interprétée par des soignants qui n’y connaissent rien. Au final, le patient concerné finit légitimement par rejeter, cette fois consciemment, des soins qu’on ne lui propose plus vraiment puisqu’il est considéré comme incapable de vouloir guérir par des soignants rejetants.
Mais qui sont donc ces patients?
La plupart ont longtemps été rangés dans la catégorie désuète de la névrose d’échec et considérés au moins comme des intolérants au bonheur, au pire comme des profonds masochistes. Il n’en est rien puisque dans tous les cas, ces « mises en échec » surviennent dans le cadre de stratégies défaillantes que les patients mettent en place pour soulager une souffrance.
Il s’agit souvent de problèmes d’addiction. Un alcoolique qui rechute, y compris en milieu hospitalier, n’est pas un patient qui refuse d’aller mieux mais un patient qui souffre du manque d’alcool et qui n’est pas parvenu à la soulager autrement qu’en buvant.
Il s’agit souvent d’une dépression, une maladie qui conjugue la souffrance morale à un pessimisme envahissant, au point de faire envisager la mort comme seule et unique solution pour se soulager. De ce fait, le patient refusera volontiers des soins qu’il considère comme vains.
Il s’agit encore plus volontiers de troubles de la personnalité, notamment borderline ou état limite dont la souffrance émotionnelle est intense et dont l’un des modes de pensée les plus typique est la dichotomisation (tout ou rien, tout blanc tout noir). Souvent accusé de cliver les équipes, voire de monter les membres du personnels les uns contre les autres, ces patients ne font que céder à cette distorsion (parfois caricaturale) de la pensée qui leur fera percevoir certains soignants comme dangereux et d’autres comme des messies.
Les passages à l’acte autoagressifs, qu’il s’agisse de suicide ou d’automutilations, sont avant tout mis en œuvre pour soulager une souffrance si intense qu’elle élimine toute autre solution, bien plus que pour défier, faire chanter ou saboter.
Mais qui faut-il alors blâmer?
Certainement pas le patient, encore moins son entourage familial. L’échec est avant tout celui du « psy ». Celui-ci devrait non seulement l’assumer mais surtout s’atteler à trouver de meilleures solutions plutôt que de chercher à se déresponsabiliser à travers des théories fumeuses. Il n’est pourtant pas scandaleux d’interrompre une prise en charge inefficace. Le vrai scandale demeure de nier cette impuissance en prétendant qu’un patient refuse d’aller mieux.